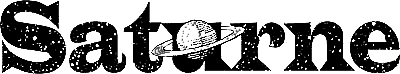Reconvilier, ne pas lâcher le combat! (I)
TEXTE: BÉATRICE GUELPA
Rappel: La Boillat, fondée en 1855, fabrique des barres et des fils
de laiton de haute précision, destinés à la connectique,
l’avionique, les télécommunications, l’informatique ou les stylos.
Une première grève de dix jours éclate en novembre 2004, à la
suite du licenciement du directeur du site. Une seconde, de
trente-sept jours, en janvier. Et 112 ouvriers ont été licenciés par
Martin Hellweg, chief executive officer (CEO) de la Holding Usines
métallurgiques suisse, qui regroupe les usines de Reconvilier et
de Dornach.
Que sont devenus les 112 ouvriers licenciés de la Boillat?
Comment Reconvilier se remet-il du séisme des deux grèves de
novembre 2004 et janvier 2006?
Je suis arrivée à Reconvilier avec l’idée que c’était fini. Que tout
était rentré dans «l’ordre» à la Boillat. Je voulais voir comment
c’est, l’ordre, après deux grèves et 150 licenciements. Et puis, je
les ai vus. D’abord, à l’assemblée du personnel, la deuxième
depuis la reprise du travail, le 2 mars. Ceux en gris. Et les autres.
Les ouvriers. Et les ex ou les malades, devant la salle
communale. Ceux qui bossent. Ceux qui bossent en étant virés,
les interdits de site, les interdits de site censés travailler. Ce n’est
plus une usine, c’est une collection de statuts. Un puzzle
impossible. Manque trop de pièces.
Comme cet Espagnol, 59 ans, viré dans deux jours, après dix-sept
ans de Boillat.
Il y a cinq minutes que la réunion a commencé et, déjà, il n’en
peut plus, sort, en retenant ses larmes. «Ça me fait mal d’être là.
Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je rentre chez moi, en
Espagne, à la fin du mois.» Exit brutal, après trente ans de vie en
Suisse.
Et puis, j’ai aperçu Sindo, petit, cheveux bouclés sur la nuque, les
yeux humides, de la peine à respirer. Sindo, qui s’assied sur un
muret, essaie de reprendre son souffle. Sindo qui ne dit rien.
Seulement que ça va aller. Et puis, en guise d’explication: «Les
cachets, c’est les cachets, j’en prends cinq par jour. La
dépression.» Un ancien de la fonderie. Viré lui aussi, le 30 juin, à
57 ans. Sindo, qui me répète avec son accent de là-bas, du nord
de la Castille: «Je suis une vieille ferraille. A quoi ça sert de lutter?
C’est la muerte, la muerte.»
J’ai vu Fred, la trentaine. Et puis encore Renald, 60 ans. Renald
écoeuré, depuis qu’Unia leur a conseillé de reprendre le travail, le
23 février, après trente-sept jours de grève, parce que «sinon, ici,
ce serait le désert». Dégoûté, lui, l’ancien syndicaliste de la
FTMH, devant ce «syndicat de compromission. J’ai pas dit
compromis, j’ai dit compromission!» Ecoeuré à s’en rendre
malade, dès qu’il approche des voies de chemin de fer, collées
contre l’Usine 2. Fred aussi est malade. Ils ont tous l’air malades.
Et cela n’a rien à voir avec les accusations de la direction qui
parle d’une «équipe de maladie», en pensant à «équipe de
sabotage». Ça fait mal, le désespoir. Ça rend fou, l’impuissance.
Perdre son boulot, tout perdre, peut-être, après avoir tant espéré.
Comment cela ne laisserait pas de traces?
Et pourtant, ils disent que ce n’est pas fini. Veulent croire que le
combat continue. La Boillat vivra. «On ira jusqu’au bout», dit
Fred. Au bout de quoi, il ne sait pas. «On est devenu des icônes,
on ne doit pas lâcher. Faut que ça serve d’exemple. Y a des gens
qui comptent sur nous, dans ce pays.» Montrer que la finance ne
gagne pas toujours, pas forcément. Et que le pays a besoin de
métallos. Pas que de comptables. Fred sort un bout de feuille
pliée en quatre de sa poche. C’est une action de Swissmetal, à 16
francs et 85 centimes, le sésame pour entrer à l’assemblée des
actionnaires du groupe, le 30 juin. «Ça fait mal au coeur de payer
une action, mais on pourra rentrer et poser des questions. On a
créé un fonds, Swissinvest, ça va pas se passer comme ça!» Le
fonds regroupe des petits actionnaires de différents horizons,
désireux de demander des comptes. Se faire entendre,
l’obsession de ceux de la Boillat.
Ils ont l’air déterminés. Et puis, désabusés. Au fond, ils sont tous
quasiment sûrs que c’est foutu. Que Martin Hellweg, le chief
executive officer de Swissmetal a pillé l’usine, sans raison, et que
c’est la fin. Alors, autant crever debout. C’est ce qu’ils se disent.
Mais ne disent pas. Comme Fred, qui affirme toujours croire à une
Boillat à 350 employés. «C’est mon but.» La seule chose à
laquelle il peut s’accrocher, comme à un slogan. Tout en se
sentant inutile.
Que faire face au cynisme? Ici et là, certains agitent l’idée d’une
troisième grève. Agir en juin, avant que les 112 licenciés ne
soient partis. Après, il n’y aura plus personne. On craint les
départs. On redoute les vacances. Les machines pourraient être
démontées. Lutter jusqu’au bout. Mais comment?
Fred m’emmène à l’Usine 3, repère des «ultras», de ceux qui ne
lâchent pas. Un lieu d’accueil fondé le 27 février avec des gens
d’Attac. Quatre ordinateurs, un bar, quelques tables, un casque
rouge posé sur la TV, des T-shirts «Stop à l’hémorragie
industrielle», et cette affiche du Che: «Soyons réalistes,
demandons l’impossible.» Je retrouve Sindo, derrière le bar. Il y
passe ses journées, à l’Usine 3, celle où la seule machine
présente ne fait que du café. «Quand je suis ici, je ne suis pas
chez moi à ne rien faire.» Sa femme aussi travaille à la Boillat.
«Mais pour combien de temps?» Sindo. Trois enfants. Une vie
d’exilé en zig-zag, d’une autre usine à Thoune, fermée, à un
village espagnol, puis un bar à Miami. C’était avant la Boillat. Il y
a plus de douze ans. Une vie d’errance. «C’est la muerte.» La
seule chose qui le tient? «Ma fille, elle me fait des 5,5 en maths
et en allemand.»
Il me présente José, un Espagnol encore. Pas viré, lui. Un activiste
qui me dit: «Le combat continue. On est seulement en suspension
de grève. On est toujours en lutte. Mais qui nous écoute?
Swissmetal crée la confusion en faisant croire que tout va bien,
que le boulot a repris, qu’ils ont réengagé 30 personnes. Mais
faut voir les contrats! Les gens ne comprennent plus rien.» Trente
contrats de réengagement, à des conditions misérables, signés
en catimini par des employés honteux.
Il me décrit les conditions de travail qui se détériorent dans
l’usine. Les ouvriers livrés à eux-mêmes, sans ordres, sans chefs,
le mobbing, la sécurité, aléatoire, et les gens qui changent de
métier du jour au lendemain, parce qu’il faut bien boucher les
trous. «J’ai vu un magasinier devenir électricien en une nuit.»
Non, le soufflé n’est pas retombé, me dit José. «Rien n’a changé
ici.» Seulement le sentiment d’être abandonné par tout le monde.
Il s’est donné jusqu’au 30 juin. Si rien ne se passe, il donnera son
sac. «Ça sert à quoi de se battre pour une Boillat à 60 personnes?
Dans dix ans, ce sera fini. On nous ment. La vérité, c’est qu’ils
vont laisser quelques personnes ici, pour ne pas avoir à dépolluer
le site, et qu’ils vont tout rapatrier en Allemagne.» José, sept ans
de Boillat, victime du syndrome du survivant, qui se dit:
«Pourquoi pas moi?» Et parle de son usine avec passion. «On est
fier d’y travailler», cette fonderie, montée par quelques copains
en 1855, qui a su créer un savoir-faire unique. «C’est ici qu’on a
inventé tout ça, merde! Tout ça qu’ils veulent mettre ailleurs. Et
même pas en Suisse. En Allemagne! Nous, on a créé des liens
avec l’Université de Neuchâtel, inventé des alliages… Nous, on
n’a rien pillé.» Je sens son sang ibérique bouillonner. La Boillat.
Du matin au soir. Il a compté: pas plus de six minutes sans en
parler, de cette usine! Une femme approche et confirme: «Je me
lève Boillat, je mange Boillat, je me couche Boillat. On ne pense
qu’à ça. Comment faire autrement?»
Un ancien débarque, avec sa salade sous vide et son Coca. Il
arrive du boulot, le nouveau, celui qu’il a retrouvé et rouspète.
«J’en ai marre! Après la manif, j’arrête. C’est plus possible, ces
réunions tous les soirs!» La conversation dérive sur les
extrémismes, sur Bush, Ben Laden, l’Irak, la démocratie. L’ancien
Boillat reprend: «J’ai bien réfléchi. J’ai fait ce que j’ai pu. Mais
c’est jamais assez… il y a toujours des petits reproches… Moi, je
pète un câble.»
Il n’est pas le seul. Reconvilier, 2330 habitants, est un village
meurtri et divisé. Au bar d’en face, deux non-licenciés boivent
l’apéro en regardant un match. Deux Italiens. Lucien et son
copain. Qui me parlent de la difficulté de continuer à bosser dans
une usine minée par les clans. Il y a les virés, les non-virés, les
frontaliers, qui jouent les jaunes. Des mercenaires, intéressés par
le fric. «On se sent mal. On se sent surveillé. On essaie de ne pas
trop en faire. Certains ne nous parlent plus. C’est invivable à
l’intérieur», commence Lucien. «Tu fais mal, quoi que tu fasses»,
renchérit l’autre. «Tu te fais engueuler par les commerciaux qui
engrangent les commandes et insulter par les ouvriers parce que
tu charges les camions. Ils te disent: «Qu’est-ce que tu fais pour
moi?» Qu’est-ce que je peux faire? Tu peux rien faire… J’ai fait les
deux grèves, j’étais là. Ça nous a servi à quoi ces trente-sept
jours de grève? Ça n’a pas empêché les 112 licenciements, plus
21 et 14 encore, avant!» Lucien l’interrompt. Lâche que ce qu’il
faut, c’est une troisième grève. Tout faire sauter. «Et après?»
reprend son pote. «Hellweg, il fermera la porte et il rira, parce
qu’il aura gagné. Toi, tu n’auras plus de job.» Lucien, comme les
autres, parle d’honneur, de fierté. L’autre hausse les épaules: «Ça
durera deux semaines et, après, plus personne ne parlera de ce
qui s’est passé ici. L’affaire sera classée. Ça ne fera pas bouger la
Suisse. La Suisse, elle peut pas bouger. Comme me disait mon
père: quand tu ne naît pas avec une cravate, tu fermes ta gueule.
C’est toujours toi, le perdant. C’est le fric qui gagne! Maintenant,
je pense à mon cul. A mes enfants. Même si ça dure trois mois de
plus, c’est toujours ça de gagné. Il faut être lucide.»